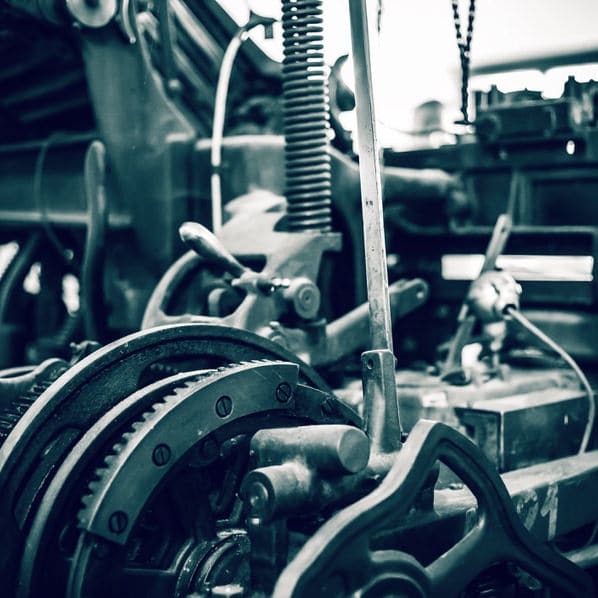Ce qui est sûr, c’est que les dessins des grottes, réalisés avec des doigts mouillés de peinture, sont déjà une sorte de produit imprimé, mais qu’ils ne fournissaient aucune reproductibilité en tant que résultat réel. Même les moines qui, au début du Moyen Âge, passaient parfois des années à recopier des livres, le plus souvent sacrés, n’étaient pas totalement exempts d’erreurs.
L’Égypte a ensuite fait le premier pas
Vers 1300 avant J.-C., les Égyptiens ont commencé à signer des décrets et des lois importants en utilisant une méthode reproductible. C’est à cette fin qu’ils ont mis au point le sceau roulant. Au British Museum de Londres, avec sa grande section égyptienne, dans de nombreux autres musées à travers le monde et également au Folkwang Museum d’Essen, on peut admirer ces sceaux roulés. Un sceau roulé est un corps cylindrique creux. Les symboles à imprimer sont gravés sur le bord extérieur. Lors du scellage, le cylindre est déroulé une fois sur toute sa circonférence, après avoir été trempé dans l’encre, sur le document à signer. Ainsi, les éléments surélevés du sceau apparaissent sur la surface. Les sceaux roulés, généralement fabriqués en marbre ou en argile et qui ne mesuraient que 4 à 6 cm de long, peuvent ainsi être considérés comme les premières véritables petites imprimantes. Dans l’Empire romain et la Grèce antique, on utilisait des anneaux de sceau à cet effet,
imprimer des documents
. Celles-ci étaient généralement en bronze et parfois même en or.
L’impression sur bois
Au 7e siècle, l’impression sur bois s’est imposée en Asie. Il s’agit de graver des caractères en miroir sur un bloc de bois qui, trempé dans l’encre, a été pressé sur le matériau à imprimer. Aujourd’hui encore, les tissus sont imprimés en Asie selon le même procédé. L’usine française de papiers peints Zuber & Cie prouve que les imprimés à la main ne sont pas passés de mode. Ils produisent des papiers peints imprimés à la main avec beaucoup de succès depuis 1798.
La gravure sur bois
La gravure sur bois, qui peut également être classée parmi les procédés d’impression en relief, est connue en Europe depuis le 1400e siècle. Il s’agit de découper des textes ou des images dans un panneau de bois et de les imprimer ensuite sur le support papier. Ceux qui connaissent la gravure sur bois du rhinocéros, réalisée par Albrecht Dürer en 1515, se rendront compte avec quelle minutie et quelle précision le matériau permet de travailler. Il est devenu très riche grâce à la vente de ses tableaux sur les marchés par sa femme Agnès. Les historiens ont calculé que, selon les critères actuels, Dürer serait plusieurs fois millionnaire. Il était non seulement excellent, mais aussi très performant. Il n’a jamais donné ses tableaux et ses gravures. Pour les œuvres de taille normale, il demandait l’équivalent de cinq chiffres en euros, auxquels s’ajoutait un zéro pour les très grandes toiles.
La gravure sur cuivre
La gravure sur cuivre est un procédé d’impression graphique en creux. La gravure sur cuivre consiste à graver l’image à imprimer sur une plaque de cuivre à l’aide d’un burin de gravure. Les lignes ainsi formées absorbent ensuite l’encre qui est imprimée à l’aide d’une presse à rouleaux.
sur le papier.
est utilisée. De nombreux artistes du 15. et Les artistes des XVIe et XVIIe siècles réalisent des gravures sur cuivre, car elles permettent d’atteindre des tirages plus importants que la gravure sur bois. L’un des plus grands graveurs du L’un des plus grands écrivains du XVe siècle était Martin Schongauer. Même le jeune Albrecht Dürer a voulu faire son apprentissage chez lui. D’après une gravure de lui, Michel-Ange a peint le tableau – La Tentation de Saint Antoine – et ce à l’âge de 12 ou 13 ans. L’image est exposée au Kimbell Art Museum à Fort Worth, USA. D’ailleurs, la formule de salutation : -Mon vieil ami et graveur- est très ancienne. Il trouve son origine dans le fait qu’après l’apparition du papier-monnaie, les graveurs étaient considérés comme ayant les compétences nécessaires pour devenir des faux-monnayeurs.
L’imprimerie
Lorsque Johannes Gutenberg a inventé l’imprimerie en 1450, l’ordre du monde a ensuite changé. Dès lors, quiconque savait lire pouvait se procurer à bon compte des livres qui, avant l’époque de Gutenberg, n’étaient réservés qu’à une petite couche, le plus souvent cléricale. De plus, les œuvres produites par transcription étaient généralement rédigées dans une langue qui n’était pas celle de la rue. Gutenberg a développé des lettres métalliques qui étaient insérées à l’envers dans un cadre de composition et qui formaient une page ligne après ligne. Les avantages de la technique d’impression sont évidents. Un autre avantage était la possibilité de recycler les lettres dans n’importe quel ordre. Cela n’avait jamais été le cas jusqu’à cette invention, car le bois perd une partie de son pouvoir d’imagerie à chaque pression.
L’impression offset
L’impression offset est un procédé d’impression qui a une longue tradition. Le procédé s’est développé à partir de l’impression sur pierre, qui a été inventée dès 1796. Comme son nom l’indique, l’impression offset est un procédé indirect. Le procédé est indirect parce que le support d’impression n’est pas en contact avec la plaque d’impression. L’impression passe par un cylindre de blanchet qui est humidifié avec de l’eau. La forme imprimante elle-même se compose de deux pages. Une face doit être maintenue sèche en permanence, car elle contient l’encre pour l’impression. L’autre côté est humidifié en permanence. En impression offset, il existe des plaques d’impression spécifiques pour chaque couleur de base. La raison en est que les couleurs doivent être divisées pour produire les différentes nuances divergentes.
L’impression en couleur
Au début du 18e siècle, la quadrichromie a été développée, chaque couleur étant composée de trois tons de base et de la couleur noire. En choisissant le bon rapport de mélange, il est possible de créer n’importe quelle couleur. Les quatre couleurs nécessaires sont le rouge, le jaune, le bleu et le noir. Ce procédé est encore visible sur les imprimantes actuelles qui utilisent le modèle de couleurs CMYK et doivent être équipées des couleurs cyan, magenta, jaune et noir.
Le procédé de copie à sec
Dans les années 50, un appareil de la société Xerox a été mis sur le marché. Le procédé d’impression, également connu sous le nom de xérographie, est basé sur l’électrophotographie et sert à la copie sèche. Certaines caractéristiques de ce procédé se retrouvent encore aujourd’hui dans les photocopieurs et les imprimantes laser.
Le 20e siècle
Le 20e siècle a apporté d’énormes progrès en matière de développement d’imprimantes ont été réalisés. Le premier copieur photomécanique a été développé dès 1907. Dans les années 1930, on expérimentait déjà le papier sensible à la lumière et le transfert photographique. En 1941, IBM a mis au point une machine à écrire conviviale avec une écriture proportionnelle. En 1957, c’est à nouveau IBM qui a mené à bien la commercialisation de la première imprimante matricielle. Les lettres n’étaient plus constituées d’éléments finis, mais étaient imprimées sur le papier à l’aide de fines aiguilles. Les premières imprimantes matricielles ne disposaient que de 8 aiguilles pour produire une lettre. Mais pour les lettres avec une sous-longueur, comme le petit g, ils atteignaient presque leurs limites. Les imprimantes matricielles modernes, utilisées aujourd’hui, possèdent 24 aiguilles. L’écriture est ainsi devenue beaucoup plus claire et nette. Au milieu des années 60, la machine à écrire à tête sphérique était la préférée de toutes les secrétaires, car elle était silencieuse et très rapide. Les machines à écrire électroniques développées par la suite offraient de nombreux avantages. Parmi les innovations, on peut citer l’alimentation automatique du papier, la compensation des marges, la justification, la mise en gras et l’effacement du texte.
L’imprimante de matrices
Avant l’apparition des photocopieuses modernes, les devoirs et les documents textuels étaient reproduits dans les écoles dans les années 60 à l’aide d’une imprimante à matrice (à alcool ou bleue). Pour ce faire, la matrice, généralement créée par les éducateurs à l’aide d’une machine à écrire, était fixée dans un cylindre qui prenait l’encre à chaque tour pour imprimer une nouvelle feuille. Le papier était toujours légèrement jaunâtre, imprimé avec une couleur bleu-violet floue et avait cette odeur caractéristique de solvant.
La sérigraphie
La sérigraphie est un procédé d’impression dans lequel l’encre est imprimée sur le matériau à imprimer à l’aide d’une raclette en caoutchouc à travers un tissu à mailles fines. La procédure nécessite plusieurs gabarits pour être exécutée. Le portrait de Marilyn Monroe est l’œuvre d’art la plus connue de l’artiste pop-art Andy Warhol. Il a été réalisé en sérigraphie. Le 22 février 2022 marquera le 35e anniversaire de sa mort.
1970 est l’année de la première imprimante à encre
La première imprimante à jet d’encre était réservée à un usage industriel et a été présentée par la société IBM en 1970. L’imprimante fonctionnait en mode continu (continuous drop) et n’était utilisable que dans le cadre d’une utilisation industrielle. Ce n’est qu’en 1984 que la HP (Hewlett-Pakard) ThinkJet est arrivée chez le client final, et ce n’est qu’en 1988 que la HP Deskjet devient une véritable imprimante pour le client final. Sa vitesse d’impression est de deux pages par minute avec une résolution graphique de 300 dpi. Mais dès 1887, la HP PaintJet a fait entrer la couleur dans les bureaux. Il n’a fallu que six ans pour passer de l’invention de l’imprimante à jet d’encre à la première imprimante laser commerciale, lancée en 1976. La première imprimante laser, l’IBM 3800, était un énorme système d’impression pour les gros travaux d’impression, comme les relevés bancaires par exemple. L’imprimante, de la taille d’une pièce, a atteint une vitesse de 8580 pages par heure, ce qui donne un rendement de 755 000 lignes par heure. Après l’apparition, vers l’an 2000, des premières imprimantes qui, grâce à des couleurs supplémentaires telles que le rouge, le bleu, le vert et l’orange, permettaient d’obtenir des impressions photoréalistes de meilleure qualité que les papiers photo conventionnels, l’ère des imprimantes photo pour les formats de papier DIN A3, puis DIN A3, a commencé. En 1987, Charles W. Hull a lancé la première imprimante 3D au monde, la SLA-1. L’appareil ne mérite pas vraiment le nom d’imprimante. Elle pourrait mieux s’appeler une machine de modélisation, car des matériaux sont appliqués lors de l’impression et disposés à la fois horizontalement et verticalement.
L’imprimante matricielle
Certains types d’imprimantes ne sont plus utilisés que de manière très spécifique. Les imprimantes matricielles très bruyantes sont donc présentes dans tous les cabinets médicaux, car la réglementation exige que les ordonnances de stupéfiants soient imprimées en plusieurs exemplaires et que le médecin ne les signe qu’une seule fois en raison du papier de copie utilisé.
Les imprimantes page et ligne
En principe, on peut distinguer deux types d’imprimantes. Le premier groupe imprime une page en tant qu’unité entière. Il s’agit notamment des imprimantes laser, des imprimantes à LED, des imprimantes ioniques, des imprimantes à transfert thermique et d’autres machines de composition. Mais pour créer des pages en tant qu’unité complète, ces imprimantes ont besoin d’une grande mémoire de travail. Les imprimantes ligne comprennent les imprimantes à roue porte-caractères, les imprimantes matricielles, certaines imprimantes à jet d’encre et les imprimantes thermiques qui impriment le ticket de caisse, notamment dans les magasins d’alimentation.
Les imprimantes d’aujourd’hui
Qu’il s’agisse d’une imprimante à jet d’encre, d’une imprimante laser ou de tout autre procédé utilisé, les appareils sont aujourd’hui polyvalents. Les imprimantes peuvent faire des copies, numériser, beaucoup peuvent aussi faxer ou se connecter directement à Internet. De nombreuses imprimantes maîtrisent l’impression couleur et, si l’utilisateur le souhaite, elles impriment également le verso de la feuille. Certains peuvent aussi être contrôlés directement via une application qui se trouve sur un téléphone portable. Pour presque chaque utilisateur, qu’il s’agisse d’un usage privé, professionnel ou industriel, le marché offre la solution d’impression individuelle sous la forme d’imprimantes multifonctions. De même, l ‘impression mobile est aujourd’hui facile à mettre en œuvre lors des déplacements.
En conclusion
Mais pour terminer l’histoire de l’impression, il ne faut pas oublier de mentionner l’impression de pommes de terre, qui est déjà très populaire dans les écoles maternelles. Les pommes de terre sont découpées de manière à obtenir des formes de triangles ou de carrés. Une fois colorées, elles permettent de créer des images tramées impressionnantes. Et ceux qui se souviennent encore de leurs années d’école se souviendront aussi des cours d’art. Le morceau de linoléum destiné à l’impression sur linoléum devient plus souple lorsqu’il est placé sur le chauffage pendant une courte période.